
Longtemps, la Moselle a été pour moi une petite pièce sur le puzzle de la France par départements que j’avais reçu le jour de mes 7 ans. Je me souviens encore de la couleur orange de cette pièce, du numéro 57 et du nom de la ville de Metz, qui apparaissait comme la préfecture. Du Finistère et de Quimper, la Moselle et Metz étaient loin. La route des vacances ne passait pas par là-bas. L’apprentissage de l’histoire, puis l’économie et la crise de la sidérurgie mirent peu à peu la Moselle sur ma carte à l’âge de l’adolescence et du lycée. Et un match de foot aussi, qui vit le club de mon cœur, le Stade Quimpérois, celui dont je portai le maillot gwen ha du (blanc et noir en breton) avec tant de fierté, sombrer un soir du printemps 1988 au Stade Saint-Symphorien dans un quart de finale de Coupe de France face au FC Metz, le futur vainqueur de l’épreuve. Mais en Moselle, je n’étais encore jamais allé et je crois bien que c’est en 1992, roulant dans ma vieille 2 CV en direction de Luxembourg et du stage qui m’attendait à la Cour de Justice européenne que j’y fis mon premier passage. J’étais passé par Thionville. J’avais vu aussi la vallée de la Fensch.
La Moselle m’est depuis devenue familière. J’y suis retourné souvent, poussant vers l’est du département et vers la frontière avec l’Allemagne. Il y a près de 15 ans, chargé d’une mission pour mon entreprise américaine, j’avais passé un petit temps à étudier l’idée de construire à Saint-Avold une usine de fabrication de panneaux solaires. Elle aurait été la plus grande de France. C’était un investissement de 100 millions d’Euros. Le choix s’était porté sur une autre région, mais il ne s’était pas fallu de grand-chose. Cela m’aurait plu que le projet se fasse en Moselle. L’énergie du futur dans un territoire que le charbon et la sidérurgie ont tellement façonné, il y aurait eu là une belle histoire à écrire et une aventure industrielle formidable à faire vivre. Ce qui m’avait touché, ce qui me touche toujours, c’était les gens rencontrés, la diversité des Mosellans, leur manière de parler de leur terre industrielle, marquée de tant de combats du monde ouvrier, et d’espérer qu’un nouveau chapitre puisse s’y écrire. Tout cela m’allait droit au cœur, économiquement, politiquement, mais c’est encore trop rationnel. Cela m’allait au cœur humainement.
Je raconte tout cela parce que je viens de tourner la dernière page d’un roman qui m’a laissé groggy. Son titre est « Ce qu’il faut de nuit » et son auteur Laurent Petitmangin. L’histoire débute dans le 54, mais le foot est dans le 57 et la trame du livre en dépend. C’est la Lorraine et c’est la Moselle. Il y a comme cela des bouquins que l’on prend et que l’on ne lâche plus, qui consument de l’intérieur, comme s’il fallait se cramponner aux pages et ce fut le cas pour moi. Ce livre est d’une sensibilité rare. C’est l’histoire d’un père seul avec ses deux enfants après la mort de la maman, un papa qui se bat pour eux trois, entre le travail, l’école, la maison et le foot. Un gars simple, attaché aux valeurs de la gauche et qui, quelque part, y croit pourtant de moins en moins, un gars qui, surtout, comprend un jour que son fils Fus (de Fussball), avec son bandana et sa croix celtique, file vers une autre rive. Ce roman m’a pris aux tripes car il confronte les convictions et l’amour paternel, ce déchirement intime, cette idée aussi que l’on peut et doit aimer malgré tout. Il y a dans ce récit une force incroyable, une émotion qui saisit à la gorge et qui demeure.
« Ce qu’il faut de nuit » est un roman, une fiction, et pourtant, j’ai vécu sa lecture comme un témoignage. De la même manière que j’avais perçu il y a deux ans « Leurs enfants après eux », le roman qui valut à Nicolas Mathieu le Prix Goncourt. J’ai vu comme une correspondance entre ces deux livres qui ont la Moselle en partage : la même interrogation sur le sens de la vie, l’avenir, la réalité brute qui rattrape le peu de rêves, le désenchantement, le déterminisme social et la tentation de fuir par tous les chemins de traverse. C’est à la fois sombre et lumineux, subtil et vif. Les personnages sont attachants, bouleversants, malgré leurs différences, sociales ou générationnelles. Est-on condamné à galérer, à ne croire en rien, à une vie triste et amère, à tout perdre avant même d’avoir vécu, à la précarité, à l’abandon et à la rage ? Ces deux livres dressent une fresque sociale rude et réaliste qu’il faut vouloir voir. Elle m’a rappelé une lecture plus ancienne, celle du livre d’Aurélie Filippetti, « Les derniers jours de la classe ouvrière », un livre plus âpre, plus militant aussi, mais qui in fine racontait la même interrogation sur l’avenir et la souffrance de ne pas en avoir.
Un roman m’a renvoyé vers un second, puis vers un troisième. Et de loin en loin, je me suis retrouvé devant mon écran avec l’envie irrésistible d’en parler et de parler de la Moselle. Une terre est-elle perdue, condamnée à l’atavisme et à la peine, parce qu’hier ne reviendra pas ? Je ne le crois pas. La réalité que ces livres racontent est bien vraie et il faut l’entendre. Comme l’est aussi la volonté de faire qui m’avait tant séduit il y a 15 ans. Et je ne sais plus très bien ici si c’est le lecteur, l’ancien cadre d’industrie, le député d’avant ou le petit entrepreneur que je suis devenu qui l’écrit. Sans doute tout le monde à la fois. Il faut donner espoir, n’ignorer aucune souffrance, ne renoncer à rien, entreprendre et entraîner. Ces allers et retours littéraires, économiques, politiques et humains m’ont rendu la Moselle plus chère encore, comme une terre de multiples passions envers laquelle il faut agir. Quand on referme un livre, le cœur conquis, viennent les envies d’après. Comme celle d’aller en Moselle prospecter, écouter, imaginer. Quelqu’un, Marie-Jo Z., m’y avait vu passer au début de l’année. Quand le virus battra en retraite, il sera temps de reprendre la route vers Metz et plus loin.
Un clin d’œil à mes amis mosellans, à Marie-Jo bien sûr, et aussi à Teresa, Stéphane, Francine, Michel, Christophe et les autres.
2 commentaires

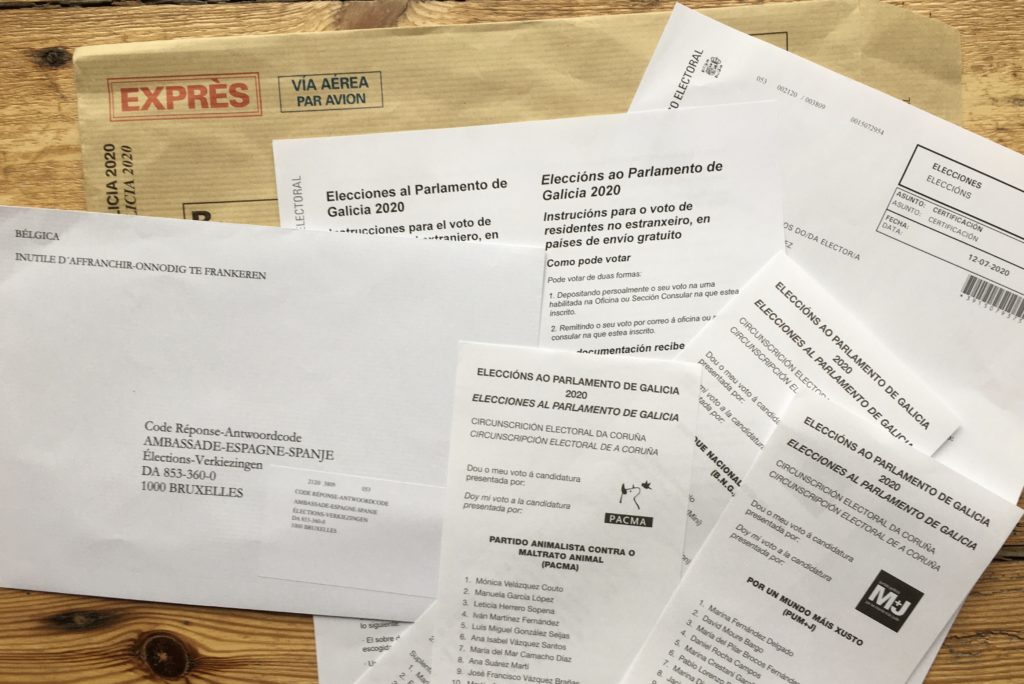
Mich’Du, le foot et les saveurs de l’enfance
Comme tant d’autres amoureux du football, j’ai été touché par la disparition de Diego Maradona la semaine passée. Son talent avait enchanté tout ce que la planète du ballon rond comptait de passionnés dans les années 1980. Le but du siècle en quart de finale de la Coupe du Monde de 1986 au Mexique contre l’Angleterre est devenu mythique, faisant presque oublier l’autre but, celui de la « main de Dieu ». On pleure un champion, une légende. Sans doute pleure-t-on aussi un peu de sa jeunesse. Les années 1980, c’était il y a longtemps. Les héros ont 60 ans et plus. Tout à ma nostalgie, je me suis demandé quelles avaient été les plus belles émotions de ma vie de footeux. Était-ce Maradona ? Ou bien Platini, les Verts de Saint-Etienne, Zidane et la Coupe du Monde de 1998 ou, plus près de nous, la seconde étoile conquise en Russie par Mbappé, Griezmann, Pogba et les autres ? La vérité, tout réfléchi, c’est que le plus grand bonheur était finalement bien plus proche de moi, à Quimper, là où j’ai grandi. C’était dans un stade ouvert à tous les vents, et notamment celui – redoutable – venu du nord, le stade de Penvillers.
J’ai l’impression d’être né avec ce stade. En réalité, je l’avais devancé de quelques années, faisant même mes premières armes de footballeur poussin sur le précédent pré quimpérois : l’antique stade de Kerhuel. Penvillers m’apparaissait immense avec sa grande tribune dressée au-dessus de la piste d’athlétisme. Les soirs de match, dans la nuit noire, on l’apercevait de loin, illuminé de mille feux sur la colline de Kerfeunteun. Quand Quimper se drapait dans l’obscurité, il devenait le phare de la ville. Notre voiture roulait vers le stade, mon père au volant. Nous allions voir jouer le Stade Quimpérois. En Division 2, parfois aussi en Division 3. On ne parlait pas alors de Ligue 2 ou de National. Les adversaires, c’était Besançon, Limoges, Blois ou Nœux-les-Mines. Autant de belles équipes oubliées aujourd’hui, comme le Stade Quimpérois lui-même d’ailleurs. On se pressait aux guichets. Il fallait courir vite vers la tribune populaire, croisant parfois les joueurs revenant de l’échauffement sur le terrain annexe. Le lever de rideau s’achevait. Un air d’accordéon, le même durant des années, annonçait l’arrivée imminente des équipes.
Le Stade Quimpérois n’a jamais gagné de trophée, jamais connu la montée en Division 1, ce fol espoir que je nourris si longtemps. Pas de tour d’honneur, de fête dans les rues de la ville. Où était donc mon bonheur ? Il était dans le charisme des joueurs, de ces types que je voyais se battre mois après mois, année après année dans le froid et le vent, parfois sous la pluie, depuis ma place dans la tribune populaire. Nous étions au milieu des années 1970. J’avais 10 ans. Dans la surface de réparation rodait un avant-centre à l’ancienne, Jacky Castellan. Il ne touchait pratiquement aucun ballon et l’un des rares qui lui parvenait finissait souvent au fond des filets adverses. Castellan avait joué en Division 1, comme quelques autres gloires de l’équipe. Je me souviens de Jose Balducci, un Argentin facétieux surnommé « Chien de luxe » car il roulait par terre au moindre tacle. Il y avait aussi le gardien de but Jean-Noël Dusé, qui se signait avec une motte de terre à l’entrée sur le terrain. Et un joueur de chez nous, Bernard Huitric, surnommé « Le muscadet » tant il était blanc, qu’une terrible blessure au genou priva cruellement d’une carrière prometteuse.
Mais la star, car il y en avait une, était un joueur venu de loin, des pays chauds disait-on alors. C’était Michel Kaham, notre arrière-droit, arrivé un jour d’été 1975 de Yaoundé à Quimper. Les supporters l’avaient prestement baptisé « Mich’Du ». En breton, cela veut dire « Michel le noir ». Je ne sais si ce surnom tout en affection serait encore politiquement correct de nos jours. La Bretagne du foot il y a 40 ans, c’était des équipes plutôt homogènes et la différence de Mich’Du tranchait. Mais ce qui tranchait encore le plus, c’était ses combats sur le côté droit, les corps à corps homériques en défense et surtout ses montées rageuses, deux ou trois fois par match, qui faisaient lever tout le monde dans la grande tribune. Penvillers adulait Mich’Du. Il s’en allait à longues enjambées le long de la ligne de touche, tout en profondeur, laissant les adversaires épuisés derrière lui, avant de centrer puissamment. Un soir, il repiqua par surprise vers le centre et décocha un tir de ouf qui finit au fond. Mich’Du avait marqué et le stade était debout. La clameur fut immense. Les gens s’embrassaient. C’est comme si nous avions gagné la Coupe du Monde. J’adorais Mich’Du.
Mich’Du était une perle par son talent, son charisme et sa grande gentillesse. Comme toutes les perles, nous avions peur de la perdre. Il était un arrière qui faisait le bonheur de tout un stade. Après deux saisons, il partit pour Tours. J’en eus le cœur brisé et tant d’autres aussi. Avec mon père, nous comprenions qu’il aille jouer ailleurs, mais il nous manquait tant. Nous en parlions parfois, comme si l’on prenait des nouvelles d’un vieil ami. France Football nous tenait informés. Une ou deux fois, il revint avec sa nouvelle équipe jouer à Penvillers. Le voir dans un autre maillot que blanc et noir nous faisait tout bizarre, mais nous l’avions ovationné aussi fort que possible. Mich’Du fit aussi une saison en Division 1 dans le nord, à Valenciennes. Reste que les soirs de match sans lui n’avaient plus la même saveur. Castellan mettait moins de buts, Balducci roulait toujours dans les surfaces de réparation. Les saisons passèrent. Il y avait moins de folie, de grandes chevauchées. La grande tribune ne se levait plus guère. Jusqu’à ce jour de la fin du printemps 1981 quand une rumeur folle se répandit comme la poudre : Mich’Du revient !
Et Mich’Du revint en effet. Sans doute notre petite ville avait-elle gardé une place à part dans son cœur. Comme il en avait conservé une, très grande, dans le nôtre. Les longues courses sur le côté droit reprirent, comme avant. La saison, malheureusement, vira au désastre et le club termina dernier, plongeant en Division 3. Un grand moment, cependant, nous attendait encore : le graal, la Coupe du Monde en Espagne ! Car Mich’Du allait la jouer. Le Cameroun s’était qualifié pour la première fois de son histoire. Pour nous à Quimper, c’était à travers Mich’Du comme un honneur par procuration. C’était aussi le moment de lui dire au revoir car nous savions qu’il partirait, cette fois-ci définitivement, de l’autre côté de l’Atlantique, pour achever à Cleveland sa carrière de joueur. Un soir de juin 1982, nous le vîmes apparaître à la télévision au milieu des Lions Indomptables. Le Cameroun allait affronter le Pérou. Mon père et moi étions tellement émus. Combien n’avons-nous pas été sans doute, à Quimper, à nous dire, écrasant une petite larme : « Putain, Mich’Du ! ». Et à être si fier de le voir jouer, y compris contre l’Italie, le futur vainqueur de cette Coupe du Monde.
C’était il y a si longtemps. J’y repense parfois. Au Stade Quimpérois, à Penvillers et à Mich’Du. La légende s’écrivait sous mes yeux, belle et simple. Le football, c’est d’abord du bonheur. J’ai encore le frisson lorsque je repense à la clameur, à cette joie qui rassemblait et transportait. Il y a un an, assistant à Quimper à l’assemblée de l’association « Produit en Bretagne », j’avais un œil nostalgique pour le stade de Penvillers, de l’autre côté de la route. C’était un jour triste et gris. La grande tribune semblait à l’abandon, comme un grand vaisseau vide. La réunion finie, je m’étais faufilé par une porte entrouverte et j’étais allé à ma place dans la tribune populaire. Seul dans le stade, face à ce terrain sur lequel on ne joue plus guère, j’entendais le vent souffler en tempête. Il n’y a plus de grands soirs, plus de lumière, plus de Stade Quimpérois. La roue a tourné et la vie avec elle. J’étais resté longtemps, à la recherche de mes souvenirs et du monde d’avant. Personne ne m’avait chassé ni vu. C’est ce foot-là que j’ai tant aimé. Sans rien gagner, on pouvait être heureux et se prendre à rêver. Je l’ai tant fait. C’était Quimper, un maillot gwen ha du, une belle histoire.