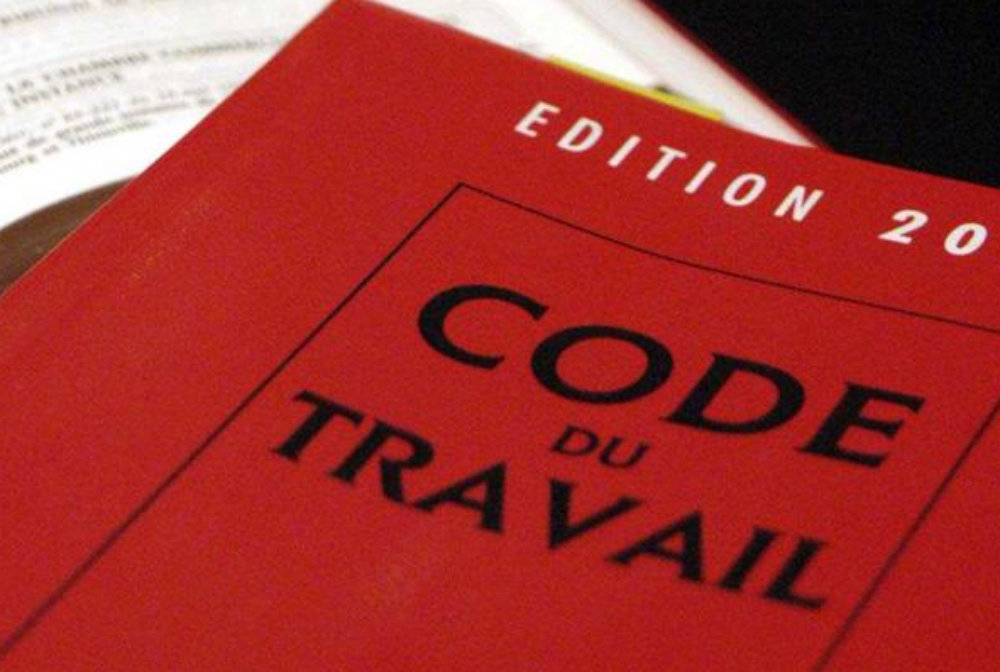Dans la foulée de la présentation la semaine passée du rapport Combrexelle, le gouvernement a annoncé une profonde réforme du code du travail. Cette annonce a suscité de l’inquiétude dans une partie du monde syndical et politique. La crainte exprimée est que l’évolution proposée par Jean-Denis Combrexelle vers une plus large place faite à la négociation collective dans les branches professionnelles et les entreprises ne se fasse immanquablement au détriment des salariés. Peu importe que le Président de la République et le Premier ministre aient indiqué que la réforme ne s’appliquerait pas à la durée légale du travail, au contrat de travail et au salaire minimum, un climat anxiogène s’est tout de suite créé autour d’une perspective qui, si elle est en effet une forme de révolution dans un pays qui se méfie de la politique contractuelle et révère volontiers la loi, faciliterait néanmoins l’accès au marché au travail et la fluidité de celui-ci.
De mes années en entreprise, j’ai acquis la conviction que certaines dispositions de notre code du travail peuvent être un handicap à l’emploi. Il y a une dizaine d’années, travaillant pour la filiale allemande d’un groupe américain, j’avais eu à piloter la création d’une usine en Allemagne, puis quelque temps après en France. Il y avait en Allemagne plus de 1 000 emplois à créer, en France environ 500. L’une des difficultés était, dans ces usines opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de mettre en place une organisation du travail reposant sur des shifts de 12 heures et non de 8 heures. Les salariés travaillaient 12 heures deux journées de rang, puis bénéficiaient d’un repos de 3 jours. Cette organisation, commune dans l’industrie des semi-conducteurs, était nécessaire pour asseoir la compétitivité de ces nouveaux sites. En Allemagne, elle avait été acceptée sans difficulté majeure. En France, ce fut bien plus compliqué, entre règles, doutes et autres incompréhensions.
Je suis un homme de gauche et partage tous les combats qui ont été ceux du monde du travail. Cette histoire, comme pour des millions de personnes, est la mienne. Je ne sais que trop combien les mobilisations collectives et autres victoires politiques ont conduit au progrès de la condition des salariés. Je n’oublie rien de cela. Je n’en renie rien non plus. Je n’en suis pas moins partisan d’une évolution du code du travail qui permette aux règles de suivre l’évolution de la société et du salariat. C’est ce à quoi conduit la politique contractuelle. Chaque année en France, entre 1 000 et 1 300 accords de branche et quelque 35 000 accords d’entreprise sont signés. C’est dire qu’il existe une volonté à l’échelle du terrain de trouver les éléments de souplesse contribuant à l’activité économique et à l’intérêt des salariés. Dans mon entreprise allemande, les plus grands défenseurs des shifts de 12 heures étaient les salariés, qui valorisaient le temps libre obtenu en retour de cette organisation.
S’inquiéter que certaines dispositions du code du travail puissent créer des rigidités inutiles n’est pas manquer au devoir de protection ni aux combats historiques du salariat. Ces rigidités ou freins sont parfois les obstacles qui se dressent entre cette part de notre population active qui crève depuis des décennies du chômage de masse et l’emploi. Je suis sensible à l’argument, développé dans plusieurs livres et articles, selon lequel la France a fait le choix des inclus contre les exclus. La première protection, c’est d’avoir un job. Or, beaucoup de décisions d’embauche sont affectées par la complexité ou au contraire par la souplesse des règles. C’est vrai pour les petites entreprises, où la création d’emploi est trop souvent perçue comme un risque dissuasif. Cela l’est aussi pour les grandes, que je connais mieux et dans lesquelles une décision d’investissement repose sur la comparaison d’un pays à l’autre et la capacité d’adaptation du cadre légitime de protection du travail.
Le code du travail est complexe, trop complexe. Vouloir le rendre plus lisible est louable. C’est un défi politique pour la gauche. Il doit être relevé. C’est un défi plus largement aussi pour notre pays et particulièrement pour le syndicalisme français, dont l’éclatement récurrent mine l’efficacité. Pour réussir le pari de la politique contractuelle, il faut un paysage syndical fort et porté à l’unité. Songeons que notre pays est, avec la Turquie et l’Estonie, celui qui, dans l’OCDE, possède le taux de syndicalisation le plus faible ! Donner plus de place à la négociation collective dans les branches professionnelles et les entreprises, c’est décentraliser le dialogue social de grandes messes nationales souvent inutiles vers l’échelon où les réelles décisions se prennent. Il doit y avoir place pour la loi, garante à l’échelle de l’Etat de l’ordre social, et une politique contractuelle efficace, qui valorise le rôle des partenaires sociaux.
Laisser un commentaire