
Il y a un peu plus d’un an, je me suis inventé une nouvelle vie professionnelle : petit entrepreneur, enseignant, conférencier, conseil en stratégie d’entreprise. Rien de ce que je fais aujourd’hui ne ressemble à ce que fut ma vie hier (et même avant-hier). Avant d’être député, j’avais toujours été salarié, travaillant pour de grandes entreprises internationales. Je gagnais bien ma vie, j’avais un statut, un boss quelque part en Europe ou aux Etats-Unis, une équipe, des collègues, des collaborateurs. J’étais jeune. Je ne le suis plus. Quittant le mandat parlementaire, j’ai compris durement que le temps avait passé. Trop vieux pour retrouver ma vie d’avant. Les choses ne sont certes jamais dites aussi brutalement, mais c’est pourtant ainsi qu’il fallait les comprendre. Je me suis retrouvé chez moi, seul, avec toute une vie à reconstruire. Une vie professionnelle, j’entends, car la vie familiale et personnelle, je l’avais et Dieu sait qu’elle est importante, primordiale même, quand viennent le revers de fortune et l’infinie solitude qui l’accompagne.
Je me suis accroché. Ne pas pleurer sur la malchance ou l’oubli, d’autant que je n’avais que rarement connu de moments difficiles jusqu’alors. J’avais eu de la chance, fait de bons choix, osé lorsqu’il le fallait. Puis la roue a tourné. Il ne sert à rien d’invoquer des circonstances ou des personnes à blâmer, au risque d’occulter ses propres erreurs aussi, et des erreurs, j’en fis. Notamment celle de ne pas cultiver mes réseaux professionnels lorsque j’étais parlementaire. La conquête d’un mandat est une aventure exaltante. Son exercice est passionnant, c’est ainsi que je l’ai vécu. La perte d’un mandat est à l’inverse une épreuve, comme un travail de deuil. Il faut dépasser les regrets et la peine, ne rien oublier des bons moments et surtout regarder devant. J’ai créé ma petite entreprise, commencé à enseigner ou plutôt à partager ma passion du droit, puis des missions de conseil sont venues peu à peu. Je suis profondément reconnaissant à ceux qui m’ont fait confiance. Ils ne me connaissaient pas. Si je suis reparti sur la route, c’est avec eux et pour eux.
Aujourd’hui, le temps s’écoule entre un petit bureau sous les toits de ma maison de Bruxelles et les missions. Le fil qui relie ces vies successives, c’est le bonheur du contact humain, le goût des gens. Plus que tout, j’aime ces moments d’échange, comme hier avec les étudiants de Grenoble. Ou avec les patrons de PME, les élus locaux ou les responsables associatifs. La vraie vie, en somme, avec la passion, les idées, la volonté d’entreprendre et de faire. Ma route me conduit vers de grandes villes de France, mais surtout vers de plus petites et vers le monde rural. Je suis de ce monde-là. J’aime la France des TER, des routes départementales et des petits hôtels (au point parfois d’en être le seul client). J’aime la France de la presse locale. Ma toute première expérience professionnelle fut un stage au Télégramme de Brest. 30 ans et plus après, on ne se refait pas : ouvrir le Dauphiné, Sud-Ouest ou les DNA au réveil est un bonheur. Palper le papier, tourner les pages avec gourmandise, apprendre, s’informer et parfois s’émouvoir reste un moment privilégié.
La France est un pays génial, généreux et fragile. C’est un pays qui doit se réformer, c’est aussi un pays qu’il faut entendre. Si le langage de vérité est nécessaire, la pédagogie l’est tout autant. Aucune réforme, aucun contrat social n’est pérenne s’il n’est pas expliqué, partagé et justifié. La réalité de la France est tout à la fois celle d’une Nation unie et d’une collection de territoires dont les différences et les volontés multiples, loin de constituer des handicaps, forment au contraire une immense richesse. La France est diverse et cette diversité est notre chance. Je crois volontiers à sa place dans le récit national. Les Français ont la passion de l’égalité. Il ne faut ni l’ignorer, ni la brocarder. Car l’égalité est la condition du vivre ensemble, d’un territoire à l’autre, d’une réalité à une autre. Il ne peut, il ne doit y avoir en France de relégation territoriale, sociale et générationnelle. Or, cette relégation existe et il faut la combattre. L’inégalité de destin est un poison. C’est à la racine qu’il faut s’y attaquer, en valorisant les initiatives locales, en les soutenant aussi.
Sur ma route, il y a des visages et des histoires, des itinéraires inédits et surprenants, des gens qui se battent, des gens qui y croient. Là où je me rends, je vois tant d’idées, tant de projets, tant d’entrepreneurs qui osent et qui se lancent. Je ne suis plus dans la vie publique. Je suis parmi eux et quelque part, je suis aussi l’un d’entre eux. Je les écoute, je les défends. Je n’ai pas de grands moyens. Lorsque l’on recommence tout, on n’a pas finalement grand-chose si ce n’est l’envie, l’énergie, et c’est déjà beaucoup. Au fond, il faut se serrer les coudes, s’allier, agir ensemble. « Sky is the limit », c’est vrai, à condition cependant que le chemin qui conduise au ciel (ou plutôt au succès!) ne soit ni trop tortueux, ni décourageant. C’est l’une des leçons, la première sans doute, que je retiens de cette nouvelle vie. Nelson Mandela disait : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ». Je m’aperçois aujourd’hui qu’il avait sacrément raison. Sans doute est-ce pour moi encore trop tôt pour gagner, mais certainement pas pour apprendre.
4 commentaires

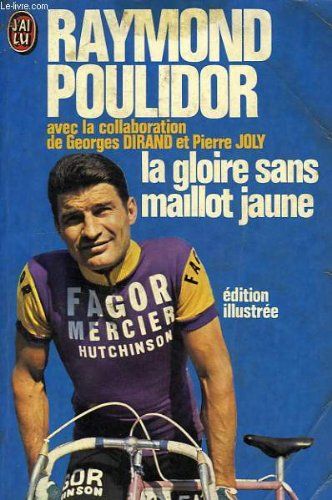
Réaffirmons la vocation européenne des Balkans
J’aime les Balkans occidentaux. L’histoire de l’Europe s’y est écrite, souvent tragiquement. Et une part de son destin s’y joue. J’ai sillonné inlassablement et avec passion ces pays durant des années. J’allais à la rencontre des Français qui y sont établis, dans les capitales et souvent bien au-delà, vers des réalités locales volontiers méconnues des radars politiques et médiatiques. Ces voyages étaient également l’occasion d’échanger avec les autorités et les forces politiques des pays visités. En juin 2014, j’avais reçu à l’Ambassade de France à Skopje le leader de l’opposition Zoran Zaev, au moment où la future Macédoine du Nord s’enfonçait dans une crise profonde sous la férule autoritaire du Premier ministre nationaliste Nikola Gruevski. Cette conversation m’avait beaucoup marqué. Zoran Zaev craignait d’être arrêté. Il m’avait dit avec émotion son attente de l’Europe, au nom de la démocratie, au nom de l’Etat de droit à construire, pour l’avenir même de son pays. Zoran Zaev est aujourd’hui Premier ministre et Nikola Gruevski est en exil en Hongrie.
L’Europe est un espoir commun à tous les peuples des Balkans. Il faut l’entendre et le comprendre. L’Europe est la condition de leur développement économique, du vivre-ensemble et de la paix dans un espace où l’instabilité reste toujours une menace. Tant d’efforts ont été faits à Skopje et à Tirana ces dernières années. Songeons au courage qu’il aura fallu à Zoran Zaev et à l’ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras pour trouver un compromis sur le nom de Macédoine du Nord, signer tous deux l’accord de Prespa en juin 2018 et le faire ratifier par leurs Parlements, où les choses n’étaient pas nécessairement acquises. Prenons la mesure des profondes réformes économiques et budgétaires conduites par le Premier ministre Edi Rama en Albanie dans un climat politique difficile et souvent surchauffé. Ce sont autant de preuves que le chemin vers l’Europe est pris et il revenait à l’Union européenne de le reconnaître en autorisant l’ouverture formelle des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. Il n’en a malheureusement rien été.
Le veto opposé par la France à l’ouverture des négociations d’adhésion m’a beaucoup peiné. Je ne le comprends pas. Certes, le processus d’adhésion à l’Union est bureaucratique et par trop automatique. Certes, l’Union doit réformer ses règles internes de fonctionnement. Tout cela est juste, mais fallait-il fermer la porte à des négociations dont on sait qu’elles dureront au bas mot une dizaine d’années et qu’elles contribuent d’expérience à la stabilisation et au progrès de l’Etat de droit dans les Etats candidats ? Ce refus renvoie tous les Etats des Balkans, et pas seulement la Macédoine du Nord et l’Albanie, à leur perception récurrente de vivre aux marges de l’Europe et d’en être méprisés. Cette perception est redoutable car elle alimente toutes les rhétoriques nationalistes. Le refus européen ouvre aussi le champ libre à la Russie, à la Turquie et à la Chine, trop heureuses de voir l’Europe se désintéresser d’une région qu’elles ont à l’inverse et depuis longtemps identifiée comme stratégique. Pour cette raison également, le refus d’ouvrir les négociations d’adhésion est une erreur.
Il existe un scepticisme français à l’égard des Balkans, qui traverse les formations politiques, d’hier et d’aujourd’hui. J’avais pu l’éprouver en bataillant des années à la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale pour que l’avenir européen des Balkans occidentaux puisse y faire l’objet d’un débat. En fin de législature, j’avais été chargé avec mon collègue Jean-Claude Mignon, ancien président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, d’un rapport sur cette question, trop tardif pour qu’il puisse avoir un impact utile. Dans ce rapport (www.pyleborgn.eu/2012-2017/presentation-du-rapport-parlementaire-sur-les-balkans-occidentaux-et-letat-de-droit), Jean-Claude Mignon et moi soulignions la vocation d’adhésion à l’Union européenne des pays des Balkans occidentaux et le travail de réforme nécessaire dans chacun de ces pays pour y parvenir, en particulier sur les questions d’immigration et de sécurité. Nous insistions également sur le besoin pour la France de s’affirmer dans une région où elle est insuffisamment présente depuis des années, à la différence d’autres pays européens. Le défi n’en est que plus grand désormais…
Une chose est sûre : il n’y a pas de progrès européen sans confiance, sans débat, sans concertation, sans compromis. Tout cela fait défaut à l’Europe en ce moment et il est permis de s’en inquiéter. Je partage la volonté européenne du Président de la République. Il ne peut y avoir d’Europe faible dans le monde contemporain. Je redoute cependant l’écart entre l’ambition, souvent affirmée de manière fracassante, et la réalité prosaïque des faits. A trop faire cavalier seul, on peut ne plus voir grand monde derrière soi en se retournant. Ne laissons pas les Balkans occidentaux verser dans la désespérance, réaffirmons leur destin européen et mettons-y les moyens, y compris financiers. L’élargissement ne doit pas devenir un tabou. Lorsque j’étais député, je me rendais dans les cimetières du front d’Orient, là où reposent des milliers de soldats français. A Bitola en Macédoine du Nord, à Korça en Albanie, c’est leur mémoire que je voulais honorer. Et aussi la promesse de l’Europe, qui vit sur ces terres pétries d’histoire, là où ont commencé des guerres, là où il faut construire l’avenir, le leur, le nôtre.